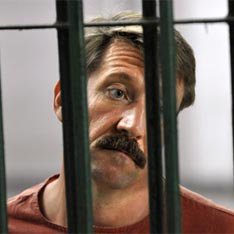- Non! Chaque femme n'est pas en quête de son prince charmant, elle sait qu'il n'existe pas. C'est la désillusion d'un mythe moderne dont on se passerait bien. Par contre, celui du mariage beaucoup de femmes et d'hommes y croient encore, bien qu'une certaine érosion se fasse ressentir d'année en année. C'est au XIIIème siècle que le mariage chrétien s'invente. Les fondements sont la monogamie, la pérennité mais surtout l'approbation parentale. Dès l'adolescence, ce sont les parents qui forment les couples et donc leurs liens matrimoniaux à venir et indissolubles. Quoique… si l'épouse ne donne pas de descendant, le mari se met souvent à côtoyer d'autres femmes qui pourront engendrer des héritiers. L'homme peut alors répudier la femme qu'il a épousé.
- Ne pas être en mesure d'avoir des enfants est dangereux et en avoir pouvait s'avérer risqué également. Comme chacun le sait, beaucoup de femmes meurent à l'accouchement par manque d'hygiène et de moyens. La césarienne n'est autorisée qu'en cas de décès de la mère. Le taux de mortalité en couches est élevé au moyen-âge, ainsi que les abondons et infanticides.
- Légale, la prostitution ne suffit pas à canaliser tous les instincts et parmi les crimes commis, le viol en fait partie. Les sanctions sont différentes selon le rang social de la victime. S'il s'agit d'une femme engagée, d'une chaste ou religieuse la sentence peut aller jusqu'à la pendaison. Par contre il écope seulement d'une amende sous forme d'indemnité à la victime si cette dernière est issue d'un contexte plus insignifiant. [Voir le tome I de la saga Castel-Bayart "Les catins médiévales"]
- La femme médiévale doit (idéalement) être élancée, avec la taille mince, les jambes longues, la poitrine haute et petite. Les poitrines généreuses sont bannies et doivent donc être bandées. Cela évolue ensuite vers la forme incurvée d'un S : la tête légèrement inclinée vers l'avant, la poitrine effacée, le ventre et les hanches projetés vers l'avant.
- Les femmes participent activement à la vie économique. En ville, elles travaillent dans le commerce, le textile et l'alimentation. En campagne, elles aident également leurs maris aux travaux des champs et de la ferme. Lingères, bonnetières, couturières, tavernières, blanchisseuses sont donc des métiers que les femmes du moyen-âge ont occupés. Déjà il y a plusieurs siècles, les salaires féminins sont très inférieurs aux salaires masculins. Comme quoi ça n'évolue pas vite !
''Que
ce soit à travers le jeu de la courtoisie ou le mariage, la femme
du Moyen Âge demeure un objet. Investigatrice du péché originel, on soupçonne
la femme de porter l'hérésie, de porter le maléfice, le poison. Le sexe féminin
est considéré impétueux, incapable d'assouvissement et dévorant. Les chevaliers
n'ont qu'un seul remède pour vaincre ces corrompues et corruptrices (Ève) : le
mariage. En effet, ce dernier désarme totalement la femme en la rendant mère.
Pour elle, une grossesse n'attend pas l'autre, et ce, avec une chance sur deux
d'en mourir. Ceci favorise... la polygamie.'' Chaucer